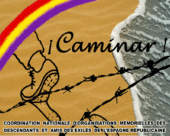la mémoire de l’exil républicain
En ce début du XXIe siècle, la mémoire de l’exil républicain en France présente des caractéristiques liées tant à la longue histoire de cette mémoire qu’au contexte mémoriel français dans lequel elle s’inscrit. La première génération avait des mémoires diverses, plurielles, reflétant les divisions du camp républicain ; mais c’étaient des mémoires de combattants, des mémoires de lutte. Des mémoires de vaincus, mais des mémoires de militants. Une partie de la seconde génération, influencée par le contexte mémoriel international et français, a parfois la tentation de porter des mémoires par procuration qui, souvent, tiennent lieu de l’identité politique manquante dans le monde présent. Pour cela, l’aspect caractéristique de ce type de mémoire est la victimisation et la mémoire se convertit en une mémoire de victimes, non de combattants.
Le contexte mémoriel en Espagne et en France
Il faut rappeler brièvement les contextes espagnols et français dans lesquels s’inscrit la mémoire de l’exil. Dans l’Espagne franquiste, les républicains : des vaincus dont il fallait effacer toute trace. Pendant des années – au moins jusqu’au milieu des années soixante –, la seule vision autorisée de la guerre d’Espagne était, celle d’une « Croisade espagnole» contre l’athéisme. Puis le franquisme parla d’une « guerre de libération ». Et il s’agissait d’éradiquer toute trace de la République.
L’histoire des vaincus de la Guerre civile – et, particulièrement celle des exilés républicains – fut ainsi ensevelie pendant des décennies sous la propagande franquiste. Les républicains espagnols étaient considérés comme de dangereux « rouges », qu’il fallait impitoyablement pourchasser et dont il fallait supprimer jusqu’au souvenir. D’ailleurs, le régime, non content d’exercer une forte répression par rapport à ses opposants restés dans la Péninsule, n’a cessé de poursuivre de sa vindicte les exilés eux-mêmes, ne cessant de faire pression sur les pays d’exil, particulièrement sur les gouvernements français, pour que les exilés soient surveillés, réprimés, voire extradés pendant la période vichyste.
Après le retour de la démocratie en Espagne, ce n’est que progressivement que l’histoire de la guerre et de l’exil a ressurgi. Mais, ce n’est qu’au XXIe siècle que l’exil et la répression franquiste sont véritablement entrés dans le débat public La loi de Mémoire historique adoptée en 2007 permet certaines avancées par rapport à la reconnaissance des républicains persécutés par le franquisme mais, du fait de la loi d’amnistie de 1977, les sentences des tribunaux d’exception qui s’étaient érigés en juges des « délits politiques » ne sont toujours pas abrogées.
En France : les républicains espagnols du statut d’ « indésirables » à celui d’anciens combattants oubliés
En France, quel écho rencontra la voix des vaincus de la guerre d’Espagne ? En 1939, pratiquement aucun, sauf dans les secteurs de la classe politique et de l’opinion publique françaises qui avaient soutenu la République espagnole. Pour les pouvoirs publics, les républicains espagnols qui cherchaient refuge sur le territoire français étaient considérés comme des étrangers « indésirables ».
Car on retrouvait en 1939, en France, les mêmes clivages qui avaient déchiré l’opinion publique et la classe politique pendant la guerre d’Espagne. Si une partie de la population et de la classe politique demandait que l’on accueillît dignement les « combattants de la liberté », d’autres secteurs de l’opinion ne cachaient pas leur inquiétude face à ce flot de réfugiés jugés souvent inquiétants et se déclaraient favorables à des mesures de contrôle, tandis qu’une frange extrémiste affichait sa haine et son mépris.
À la Libération, les républicains espagnols – qui avaient combattu au coude à coude avec les Français dans les maquis – furent soutenus par les gouvernements français issus de la Résistance. Et il y eut, pendant plusieurs années, jusqu‘au début de 1948, une sympathie active des gouvernements français, intervenant à l’ONU, fermant la frontière avec l’Espagne et appelant à ne pas reconnaître le régime franquiste. Mais la survenue de la guerre froide, les changements de majorité politique, le souci des pays anglo-saxons, mais également de l’URSS, de ne pas provoquer de bouleversements dans la Péninsule ibérique, puis l’entrée de l’Espagne franquiste à l’ONU en 1955, firent que la voix des républicains espagnols se heurta peu à peu à l’indifférence générale.
En 1950, la vie politique française se trouvait fortement marquée par la guerre froide, exacerbée par le déclenchement de la guerre de Corée, et l’on redoutait une vaste entreprise de subversion communiste. Ce qui aboutit à l’interdiction de toutes les organisations communistes espagnoles de l’exil, et notamment de l’Amicale des anciens FFI et résistants espagnols qui portait la mémoire d’une grande partie de la lutte armée menée en France par les Espagnols pendant l’Occupation.
En cette même année 1950, le régime franquiste remportait ses premiers succès internationaux : les États-Unis consentaient un prêt en août et, en novembre, l’ONU annulait sa résolution du 12 décembre 1946, ce qui laissait ses pays membres libres de rétablir des relations diplomatiques avec l’Espagne. De ce fait, les relations diplomatiques furent rétablies entre la France et l’Espagne en janvier 1951.
À peine plus de cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’établissement de relations normales entre les deux pays ne pouvait que marginaliser les républicains espagnols. Vaincus en Espagne, ils étaient considérés à certains égards comme encombrants en France. Les exigences du pragmatisme politique d’État l’emportaient ensuite sur toute autre considération.
Avec l’instauration de la Ve République, les relations entre la France et l’Espagne franquiste connurent encore une autre tonalité et un resserrement sensible. La guerre d’indépendance algérienne accroissait encore les possibilités de pression de Franco sur le gouvernement français et les républicains espagnols furent l’objet de véritables tractations entre la France et l’Espagne, en échange de la surveillance dans la Péninsule d’activistes partisans de l’Algérie française. Aussi, en 1961, les principaux journaux de l’exil, socialistes et anarchistes, fondés en 1944 au moment de la Libération, furent-ils interdits. L’expression publique des exilés espagnols se trouvait singulièrement réduite.
Aussi, pendant des décennies, la participation des Espagnols à la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Français – et particulièrement à la Résistance – a été longtemps un fait peu connu, oublié des historiens français jusqu’à une date fort récente[1] et en tout cas largement absent de la mémoire collective française.
La mémoire combattante a été honorée en 1994 à Prayols, dans l’Ariège, au plus haut niveau gouvernemental, mais cantonnée dans un aspect local et partiel. La prise en compte de l’exil républicain dans sa globalité fut plus tardive. Ce ne fut qu’en 1999, avec le 60e anniversaire de la Retirada et les importantes manifestations organisées dans la ville d’Argelès-sur-Mer en septembre, que deux ministres sont venues prendre acte officiellement des déplorables conditions de l’exode républicain. Et il a fallu attendre le 60e anniversaire de la libération de Paris, en 2004, pour que la capitale se souvienne du rôle joué par les républicains espagnols.
À partir de cette date d’ailleurs, l’on peut constater que, si rien ne s’est passé au niveau national avant le 25 août 2014, diverses autorités régionales et départementales ont organisé des hommages publics aux républicains espagnols, notamment en Midi-Pyrénées (Toulouse en 2004 et 2005), en Aquitaine en 2005 ou en Languedoc-Roussillon en 2009. Sans doute, en considération du poids électoral représenté par les descendants de l’exil espagnol.
Les raisons de cet « oubli historique » sont multiples mais ce trou mémoriel s’explique d’abord par la manière dont la France a très vite écrit, fixé pour des années, sa propre histoire de ces années-là : les mémoires dominantes de l’après-guerre, générées par les courants gaulliste et communiste, ont méconnu ou minimisé la participation des étrangers à la Résistance[2].
Ce long effacement mémoriel a également des causes issues des exilés espagnols eux-mêmes. Les antagonismes politiques mis au jour pendant la guerre de 1936-1939 et exacerbés dans l’exil ont assurément empêché la constitution d’une mémoire commune. Au-delà des clivages, la préoccupation principale des réfugiés espagnols était l’Espagne. La participation à la Résistance en France n’avait été pour beaucoup qu’une étape moralement et politiquement obligée dans la longue marche qui devait aller de l’exode à la « reconquête » de l’Espagne. Après 1945, l’activité militante des exilés espagnols est restée centrée sur la lutte antifranquiste. Le temps était au combat contre la dictature et non à la construction d’une mémoire historique.
Une historiographie lente à se constituer
C’est seulement à partir des années 1960 que des responsables politiques ou syndicaux, des écrivains ou de simples acteurs des événements se sont mis à écrire. La grande majorité de ces récits concernait les camps d’internement en France et en Algérie, les camps d’extermination nazis, et, de façon générale, l’ensemble des années de la Deuxième Guerre mondiale, marquées par la difficile arrivée en France, le travail plus ou moins forcé dans les Compagnies de travailleurs étrangers, la guerre dans des unités militaires françaises, l’engagement dans la Résistance ou la déportation. Le plus douloureux du drame des républicains espagnols est ainsi ressorti en premier au grand jour, mais avec une distance temporelle très grande. Puis, vers la fin de la dictature franquiste, de nombreux témoignages apparurent, en France et, enfin, en Espagne même.
Les premières études historiques, quant à elles, n’ont commencé à paraître qu’au cours des années 1970. Mais l’on peut dater le véritable « décollage historiographique », en France comme en Espagne, que bien plus tardivement, au tournant des années 1980 et 1990. Les études historiques proprement dites se sont développées surtout à partir du cinquantenaire de la Retirada. Depuis lors, les recherches historiques ont connu une intensification considérable. La coopération entre historiens espagnols et français s’est effectuée d’emblée.
Une mémoire vive
Dans le long processus de réémergence de la mémoire de l’exil républicain espagnol, la fin du XXe siècle constitue un moment-charnière. Le 60e anniversaire de la Retirada, en 1999, a été l’occasion de manifestations significatives, en France comme en Espagne. Dans la Péninsule, en 1999, une série de colloques s’est tenue dans les principales villes universitaires pour étudier les cultures de l’exil et en faire connaître les productions et les réalisations. Des manifestations importantes se sont tenues dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan mais surtout à Argelès avec une semaine entière de rencontres, conférences, expositions et spectacles. Deux ministres – dont le secrétaire d’État aux Anciens combattants – sont venus inaugurer une plaque de rue dédiée à la Retirada et un monolithe sur la plage, à l’emplacement de l’ancien camp ; un chêne fut planté à la mémoire des enfants enterrés dans l’ancien cimetière.
Cette importante manifestation a commencé à mettre en évidence que la mémoire des républicains espagnols était dorénavant portée par les « héritiers de l’exil », les filles et fils de républicains. La seconde génération issue de l’exil portait ainsi la mémoire des acteurs de la guerre d’Espagne, de l’antifranquisme et de l’exil. Les rangs de la génération arrivée adulte en France devenant de plus en plus clairsemés, c’était une nouvelle génération qui était porteuse de cette mémoire.
Une mémoire à vif, car longtemps oblitérée, voire occultée, tant en Espagne qu’en France, est ainsi en cours de forte émergence et de visibilité notable en cette première décennie du XXIe siècle. Les importantes manifestations organisées en 2009, pour le 70e anniversaire de la Retirada, dans plusieurs départements[3] en témoignent.
Les mémoires de l’exil républicain en France
« Mémoires de l’oubli » : la première génération. La mémoire a joué un rôle fondamental dans l’exil républicain, bien qu’elle ait été loin d’être commune.
Mémoires de la période républicaine
Les jugements relatifs à la Seconde République et les héritages revendiqués étaient différents selon les courants idéologiques et, parfois, fortement antagoniques : les uns revendiquaient la IIe République et voulaient la rétablir, les autres s’interrogeaient sur le type de régime à établir après la chute du franquisme. L’activité politique de l’exil a, en effet, été fortement marquée par les débats relatifs à la République et à son héritage. D’abord, pendant la guerre mondiale, il s’agissait d’une mémoire instrumentalisée pour des objectifs politiques. Il n’est pas indifférent que les débuts de la presse clandestine espagnole sous l’Occupation se soient situés sous les auspices de la République. La mémoire de celle-ci a été utilisée dans les premiers bulletins clandestins, notamment à Toulouse. Ensuite, des institutions républicaines ont été reconstituées. Même si l’année 1947 marque la fin de l’espoir de voir la République rétablie et si les institutions perdurent comme simple symbole, celles-ci ont probablement contribué à la persistance d’une mémoire historique de la République.
Dans le domaine culturel, la mémoire de la République a nourri l’intense activité des exilés car il s’agissait d’une mémoire identitaire. Les premières années de l’exil, les activités culturelles s’inscrivaient dans la continuité de celles de la République : comme dans les années 1930, la lutte contre le franquisme passait par le combat pour la défense de la culture. L’exil se présentait comme une résistance culturelle.
Enfin, la mémoire avait, dans l’exil, une forme ritualisée par des commémorations. Tout au long de l’exil, surtout jusqu’aux années 1960, les journaux et revues accordaient une importance constante et régulière à la mémoire historique. L’objectif était de faire revivre pour les lecteurs le souvenir de personnalités de la culture hispanique et d’événements récents de l’histoire nationale qui avaient valeur de symbole, comme le 14 avril 1931 ou le 19 juillet 1936. La presse de l’exil célébrait unanimement Cervantès, Goya, Lorca ou Machado et évoquait, à la date-anniversaire de leur disparition, selon les tendances politiques, le souvenir de militants, de responsables de partis ou d’hommes politiques emblématiques d’une juste cause (par exemple, selon les journaux, Pablo Iglesias, Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro, Salvador Seguí, Buenaventura Durruti, ou Lluís Companys). Même si, il convient de le souligner, progressivement, avec la prolongation indéfinie de l’exil, les commémorations et les rites mémoriels prenaient, dans la presse de l’exil, la place des textes programmatiques ou des propositions d’action.
Mémoires de l’exil
Dans l’exil, s’est créée également une mémoire des événements vécus depuis le départ d’Espagne, qui s’ajouta à la mémoire de la période antérieure. La mémoire de l’exil s’est alimentée de ces événements : camps de concentration – toujours désignés avec les termes utilisés au début par les autorités françaises et employé dans leur pays d’origine –, travail militarisé et engagement dans de nouveaux combats. Cependant, dans l’abondante presse de l’exil, les préoccupations étaient essentiellement d’ordre politique et culturel. Le fait de ne pas évoquer dans cette presse les difficultés vécues dans l’exil, notamment dans les camps, n’était pas uniquement dû à une certaine autocensure par rapport aux autorités françaises. On y parlait peu des camps et quand ceux-ci étaient évoqués, ou alors les Compagnies de travailleurs étrangers, les auteurs le faisaient avec une certaine ironie ou avec une distance affirmée. On demandait au gouvernement en exil de faire, pour une évaluation précise, la liste des réfugiés morts dans les camps et on estimait très utile de faire l’histoire des Compagnie de travailleurs étrangers (CTE), non pour faire montre d’animosité ou en récrimination, mais pour servir à l’histoire de l’exil et écrire le « Livre de la mort, le livre du travail et le livre de la gloire[4] ». Les livres publiés ou impulsés par des auteurs appartenant à la première génération ne se situaient pas sur le terrain de la victimisation : il s’agissait de sortir de l’oubli l’histoire des combattants. Dans l’un des livres de témoignages collectifs publiés en France sur la période de la Seconde Guerre mondiale – les camps, la participation des républicains espagnols à la guerre aux côtés des Alliés et à la Résistance –, Memorias del olvido, édité en 1996 à Paris[5], Francisca Merchán Tejero, « Paquita », vice-présidente de la FACEEF – qui avait payé durement son militantisme en Espagne par des années de prison – disait en ouverture du colloque : « Nous sommes réunis aujourd’hui non pour rendre hommage aux Espagnols d’alors, mais pour que l’Histoire ne les fasse pas passer dans un oubli définitif, ce qui serait comme les tuer une seconde fois.
Dans cette salle de nombreux survivants sont présents, qui vont pouvoir intervenir sur le pourquoi de la Résistance espagnole en terre de France […] sur les motifs de leur déportation […] [Nous voulons] que soient connues les raisons qui motivèrent des milliers d’Espagnols, femmes et hommes, à donner généreusement leur vie et leur futur[6] […]. ». Plus que d’un hommage, il s’agissait de sortir de l’oubli ces femmes et ces hommes qui avaient lutté pour leurs idéaux et de faire connaître leurs motivations. Les résistants savaient pourquoi ils luttaient, leur combat avait un sens. Le travail de mémoire consistait à rappeler les motifs de la lutte.
Le nouveau contexte mémoriel en France
La disparition progressive de la première génération de l’exil, celle qui avait vécu la guerre en Espagne, mais aussi les changements dans le contexte politique international – avec ce que l’on appelle la « mort des idéologies » – ont pu changer insensiblement la nature de la mémoire d’une partie de la deuxième génération de l’exil. Et l’on a assisté à l’émergence de différentes attitudes mémorielles. De nombreux descendants de l’exil et diverses associations se sont employés à la fois à préserver la mémoire des luttes du passé – les uns pour rappeler les réalisations de la République ou d’autres pour évoquer les essais de changements révolutionnaires de la société espagnole – et, en même temps, à mettre en pratique les idéaux et les valeurs de leurs parents, en élargissant leurs activités par des engagements dans le présent. D’autres associations, peut-être les plus visibles jusqu’à maintenant, se sont centrées exclusivement sur le passé, avec une ferveur toute particulière pour les commémorations et la conquête d’une hégémonie mémorielle. En effet, le contexte mémoriel en France et dans de nombreux pays a connu des évolutions. Beaucoup de pays connaissent une exigence de mémoire historique, particulièrement les pays qui ont vécu un système social d’apartheid comme l’Afrique du Sud ou une dictature comme plusieurs pays d’Amérique latine. Et même s’il s’agit véritablement, en ce qui concerne les questions mémorielles, d’un « processus mondialisé[7] », le contexte français possède ses spécificités.
À partir des années 1970, le modèle jacobin de la nation française, unie par-dessus les différences d’origines, a commencé à s’effriter : ainsi, pour la première fois – depuis la « guerre des 6 jours » de 1967 – des Français ont revendiqué leur identité juive[8]. Progressivement, s’est créée – comme l’écrit Esther Benbassa – « ce qui a pu être appelée la religion civile de la Shoah, avec ses commémorations, ses rites et ses saints[9] ». Comme la France sortait alors des guerres coloniales et avait de grandes difficultés à intégrer les nombreux habitants venus des anciennes colonies, il s’est développé, depuis les années 1990, une intense concurrence de mémoires[10]. La mémoire juive s’est convertie en paradigme, en modèle, de « régime victimo-mémoriel » et les autres groupes qui se sentaient une identité particulière – comme les descendants d’Arméniens, d’esclaves ou de colonisés – commencèrent à apparaître dans l’espace public. De fait, comme le dit très bien Esther Benbassa, « avec l’échec des idéologies, les luttes sociales se sont orientées vers des luttes identitaires dans lesquelles le devoir de mémoire est l’expression accomplie[11] ». Ainsi, dit-elle, « la mémoire de la Shoah servit d’exemple à différents groupes qui, à juste titre, demandent que leur mémoire de souffrance trouve sa place dans la mémoire collective française[12] ».
Un véritable « lobbying mémoriel » s’est ainsi mis en marche, depuis le début du XXIe siècle. Aussi, peut-on parler en France – bien que cette expression puisse s’étendre au monde occidental – à une « obsession mémorielle », une « fièvre mémorielle »[13]. Le témoin, de plus en plus identifié à une victime, devient une icône vivante et, comme le dit Enzo Traverso, « dans une époque d’humanitarisme, […] il n’y a plus de vaincus mais seulement des victimes ». Il existe des conflits entre les mémoires et « ce régime victimo-mémoriel octroie un pouvoir accru aux entrepreneurs de la mémoire, auxquels les politiques essaient de complaire pour des raisons électorales[14]. Tandis que l’écriture de l’histoire suppose l’utilisation de règles méthodologiques rigoureuses et une certaine distanciation, la mémoire pure prévaut dans ce type d’activité. Et, comme le décrit encore Esther Benbassa, « Le diktat des mémoires est un diktat implacable, culpabilisant, avec une multitude de devoirs de mémoire qui enferment dans un labyrinthe où la liberté et la pensée sont étouffées. Surgissent, en même temps les activistes de la mémoire, sorte de police qui impose ce qu’il convient de faire ou pas, qui enregistre tout éloignement de la doxa, la doctrine, établie d’avance[15]. »
Dans le cas de l’exil espagnol, il est certain que la reconnaissance de la mémoire blessée de l’exil et de son histoire oubliée pendant si longtemps est parfaitement légitime. Mais l’on a vu, ces dernières années, certaines associations tomber dans la dérive décrite ci-dessus. Ce qui arrive parfois présentement ce sont les discours victimaires mis en avant par le « nieto de republicano », qui effacent par ailleurs la complexité du champ politique, comme le démontre Odette Martínez-Maler[16]. Des descendants de l’exil peuvent ainsi, parfois, se convertir en « témoins de témoins », être « les témoins par procuration d’une histoire dont ils ont seulement connu des fragments de légende familiale ». Et, contrairement à ce qui se passait dans la première génération, les républicains espagnols sont alors présentés comme des « victimes » et non comme des « combattants »[17], tous les enjeux politiques de leur combat étant évacués pour laisser place à la seule considération des souffrances endurées. Ainsi, dans certaines associations mémorielles, « l’image des réfugiés comme victimes joue un rôle clé[18] » et les motivations des combats ont disparu.
Comme l’observe Esther Benbassa de façon générale pour diverses associations qui ne sont pas liées à l’histoire espagnole, mais davantage liées à l’esclavage et à la colonisation : certaines associations ont créé « une sorte de culte séculier, avec des rites, des cérémonies, des interdits exercés à l’endroit de quiconque n’accepterait pas leur hégémonie[19] ». Remarque qui peut s’appliquer à certaines associations mémorielles espagnoles. Peut-on aller vers une « juste mémoire » ? Les historiens réfléchissent évidemment beaucoup à cette question. Comment sortir de l’alternative « oubli » ou « excès de mémoire » ? Comment prendre en compte les souffrances sans évacuer les enjeux politiques ? Comment trouver cette « juste mémoire » dans le cas de l’exil espagnol ? À mon avis, deux appuis peuvent être précieux : le débat politique et le travail historique. Le premier, nécessaire dans un cadre citoyen, permet de resituer les enjeux idéologiques d’une époque, à condition de l’exercer dans le respect de la pluralité afin de ne pas s’enfermer dans un passé révolu et d’adapter ces enjeux aux nouveaux défis du présent. Dans le domaine des connaissances et de l’étude, le travail historique permet à la fois de recueillir les mémoires plurielles mais aussi de « reconstituer comme un puzzle, avec la distanciation que requiert ce genre de travail, le contexte qui a rendu possible ces crimes et ces injustices[20]. »
Déjà, de nombreuses associations de descendants de l’exil espagnol, dont celles qui créent aujourd’hui la coordination Caminar, s’efforcent d’arriver à cette « juste mémoire » de l’histoire qu’ont vécue leurs parents, partageant ainsi, de fait, l’opinion de Benjamin Stora, historien spécialiste de la guerre d’Algérie, événement qui constitue encore une blessure vive dans nombre de mémoires : « Il faut trouver la juste mémoire, entre répétition des guerres anciennes dans le présent et oubli de faits qui peuvent conduire à un révisionnisme généralisé. […] Le travail historique aide à sortir de ce dilemme entre excès et absence de mémoire. […] Mais l’historien doit maintenir la porte ouverte aux controverses citoyennes et prendre en compte le contexte de son époque afin de sortir des rancœurs du passé et des blessures mémorielles. En faisant cela, l’historien recrée sans cesse les instruments d’un travail de mémoire jamais fermé[21]. ». Le travail d’histoire comme le travail de mémoire ne sont jamais ni fermés ni terminés. « Il n’y a pas de repos dans la vérité », écrivait Albert Camus[22]. »
Geneviève Dreyfus-Armand
[1] Le premier colloque scientifique à l’étudier est celui consacré aux Italiens et Espagnols en France, 1938-1946 tenu à Paris en novembre 1991 (publié sous le titre Exils et migration, chez L’Harmattan, en 1994).
[2] Stéphane Courtois, Denis Peschanski et Adam Rayski, Le Sang de l’étranger : les immigrés de la MOI dans la Résistance, Paris, Fayard, 1989.
[3] Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Loiret, Lot, entre autres.
[4] L’Espagne républicaine, n° 56, 20 juillet 1946.
[5] Memorias del olvido. La contribución de los Republicanos españoles a la Resistencia y a la Liberación de Francia, Paris, FACEEF (Fédération des associations et centres d’Espagnols émigrés en France), 1996.
[6] Francisca Merchán Tejero, “Apertura y objetivos”, in Memorias del olvido, op. cit., p. 17 [palabras puestas en itálico por la autora].
[7] Benjamin Stora, « La France et “ses” guerres de mémoire », in Les Guerres de mémoires. La France et son histoire, Pascal Banchard et Isabelle Veyrat-Masson (éds), Paris, La Découverte, 2008, p. 10.
[8] Esther Benbassa, La Souffrance comme identité, Paris, Fayard, 2007 (Colección Pluriel, 2010, p. 201).
[9] Esther Benbassa, « “Juste mémoire” ou raisonnable oubli », préface à Johann Michel, Gouverner les mémoires. Les politiques mémorielles en France, Paris, PUF, 2010, pp. ix-xv.
[10] Les Guerres de mémoires. La France et son histoire, op. cit.
[11] Esther Benbassa, « À qui sert la guerre des mémoires ? », in Les Guerres de mémoires. La France et son histoire, op. cit., p. 258.
[12] Esther Benbassa, « La concurrence des victimes », in Culture post-coloniale, 1961-2006, Pascal Blanchard et Nicolas Bancel (dir.), Paris, Autrement, 2006, pp. 102-112.
[13] Enzo Traverso, Le Passé, modes d’emploi ; histoire, mémoire, politique, Paris, La Fabrique éditions, 2005, p. 12.
[14] Esther Benbassa, « “Juste mémoire” ou raisonnable oubli », art. cit., p. XIV.
[15] Esther Benbassa, « La concurrence des victimes », art. cit., p. 592.
[16] Odette Martinez-Maler, « Passeur de mémoire et figure du présent : el nieto de republicano », in Culture et mémoire. Représentations contemporaines de la mémoire dans les espaces mémoriels, les arts du visuel, la littérature et le théâtre, Palaiseau, Éditions de l’École Polytechnique, 2008, pp. 43-52.
[17] Ibid., p. 51.
[18] Federica Luzi, «La reinvención de la identidad colectiva de los descendientes de los refugiados españoles », Exilios y migraciones, à paraître.
[19] Esther Benbassa, « La concurrence des victimes », art. cit., p. 590.
[20] Ibid, p. 591
[21] Benjamin Stora, « La France et “ses” guerres de mémoire », art. cit., pp. 12-13.
[22] Pierre Laborie, « Mémoire et histoire », in Une Histoire d‘imposture, les habits neufs du stalinisme ou comment l’apposition d’une plaque sur une place publique de Cahors révèle des tentatives de manipulation mémorielle, Collectif « Les Autres », [Paris], Recherche et documentation d’histoire contemporaine, 2012, pp. 233-234.