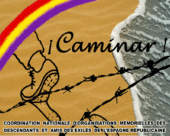Madrid tombe le 29 mars 1939 – Edouard Pons nous plonge dans cette tragédie
« Madrid retenait son souffle pour que nul ne s’aperçoive de son existence… Madrid se cachait, terrée dans sa coquille de peur et de silence, guettant secrètement derrière les persiennes, anxieuse, dans l’attente du pire ». Un récit du journaliste et écrivain républicain Antonio Otero Seco sur la chute de Madrid, il y a 80 ans, et « l’inhumaine vengeance franquiste ».
Sous l’image de la couverture du livre d’Antonio Otero Seco, nous reproduisons, avec son accord, un article d’Edouard Pons, journaliste, traducteur et militant de la mémoire, publié sur son blog de Médiapart à l’occasion de l’anniversaire de la chute de Madrid.

traduit par Albert Bensoussan, éd. Folle Avoine, 2018
« Un silence pesant, angoissant, s’abattit sur Madrid. On aurait dit que la ville retenait son souffle pour que nul ne s’aperçoive de son existence. Madrid était silencieuse mais ne dormait pas. Madrid tout entière se cachait, terrée dans sa coquille de peur et de silence, guettant secrètement derrière les persiennes, anxieuse, dans l’attente du pire »
Antonio Otero Seco, évoque ainsi cette nuit du 29 mars 1939 où, pour la première fois après trois années de guerre civile et d’acharnement des militaires factieux et des « oiseaux noirs » de l’aviation allemande, les bombardements ont cessé sur Madrid. Le Madrid républicain du « No pasarán », lancé par Dolores Ibaburri, « la Pasionaria », Madrid qui devait être la « tombe du fascisme », « cœur de l’Espagne » et « capitale de la gloire », chanté par Rafael Alberti, le Madrid de L’espoir, des Brigades internationales, est sur le point de tomber entre les mains du « généralissime Francisco Franco », « caudillo par la grâce de Dieu » … et l’aide de Hitler et Mussolini.
Journaliste, écrivain, poète, proche notamment de Miguel Hernandez ou de Federico García Lorca, dont il fit la dernière interview avant son assassinat, Antonio Otero Seco a 34 ans. Il assiste aux dernières heures de la République, pour laquelle il a activement milité et dont il a couvert les combats pour plusieurs journaux.
Il en témoigne dans un récit poignant, écrit dans les années cinquante, qui rend compte également de son arrestation et de ses années de prison alors que « l’inhumaine vengeance franquiste » s’abat sur tous ceux qui n’ont pas embrassé la cause des putschistes contre le gouvernement républicain légitimement élu, laissant « un interminable sang dans les campagnes », comme écrira Alberti.
Ce récit, « Vie entre parenthèses » vient d’être publié dans une traduction d’Albert Bensoussan, par les éditions Folle Avoine, qui ont également édité en 2016 la poésie d’Otero Seco.
Le matin de ce 29 mars déjà, alors que les troupes de Franco ne sont pas encore entrées officiellement dans la ville, les fascistes du parti de la Phalange, parcourent la capitale sur des camions à la « chasse aux rouges », aux cris de « Franco ! Franco ! Franco ! » et « Arriba España ». Otero Seco décrit « une foule craintive qui ne sait où cacher sa peur, son dégout, son angoisse », « des hommes et des femmes avançant comme des somnambules, avec une rigidité d’automates ».
Le soir venu, « les ombres de la nuit ouvrent la voie aux règlements de compte ». « Parfois, un camion s’arrêtait devant une porte et, peu après, des cris de femmes, perçants comme des poignards, couvraient le ronflement des moteurs », raconte Otero Seco, qui évoque le coup sec des portières, des tirs au loin, des sanglots en sourdine, les pleurs d’un enfant. « Les hommes, le teint pâle, essayaient de tranquilliser les leurs avec des paroles d’encouragement que trahissait le tremblement de la gorge, tandis qu’ils pensaient à trouver une forme de suicide le moins douloureux possible », ajoute-t-il.
Il dit en peu de mots la dignité des uns, l’ignominie des autres, la souffrance et la fraternité d’un côté, la cruauté et la barbarie de l’autre. Il ne cache pas pour autant les disputes, injures, menaces de certains responsables de la République pour monter dans les derniers camions partant vers Alicante, ultime enclave libre de fascisme d’où certains espèrent – ce sera en vain – pouvoir embarquer vers un éventuel exil. Il se montre plus indulgent pour ceux qui, sous la menace, font rapidement de leurs poings fermés des mains tendues ou qui, à défaut de drapeaux rouge et jaune des franquistes mettent des couvertures colorées au balcon en signe d’hommage improvisé aux vainqueurs, espérant peut-être leur indulgence.
Il monte lui aussi dans un camion partant vers l’est puis se ravise et se rend chez ses parents où, la nuit du 9 avril, pistolet au poing, les hommes en uniforme noir de la Phalange – « ce dépotoir idéologique des sans idéologie », dira-t-il – viennent l’arrêter. « En ce jour, l’Armée Rouge captive et désarmée, les troupes nationales ont atteint leurs derniers objectifs militaires. La guerre est finie”, avait indiqué le 1er avril le dernier bulletin de guerre, signé du « généralissime ».
Tous les lieux de détention sont bondés et Otero Seco échoue à la sinistre Direction Générale de la Sûreté. Jugé coupable « d’aide à la rébellion », il est interné huit jours après à la prison de Porlier à Madrid – 5.000 prisonniers dans un établissement prévu pour 400 – où il restera huit mois. Le 28 décembre, lors d’un simulacre de procès devant un tribunal militaire, accusé de « campagne de presse très active contre le Mouvement National », « apologie de la cause marxiste » et incitation à « la résistance armée contre l’Armée Nationale », le procureur requiert contre lui la peine de mort. Le défenseur d’office, ou supposé tel, en uniforme fasciste, sollicite trente ans de prison.
Otero Seco raconte cette farce judiciaire, au cours de laquelle trente personnes de provenances très diverses, « défendues » par un même avocat, seront jugées en 57 minutes. En préambule le procureur militaire a déclaré que « le sang des mauvais espagnols ne peut être racheté qu’en arrosant le sol de la patrie offensée ». A son retour en prison, dans l’attente du verdict, il est transféré à la cinquième galerie, celle des condamnés à mort, où attendent plus de 600 hommes. Il assiste aux « sacas », les « sorties », quand, chaque jour les geôliers font l’appel de ceux qu’ils vont emmener pour être exécutés. Leurs noms ne sont pas lus d’emblée mais lentement épelés de sorte que « la lecture de la liste semblait durer un siècle » et prolongeait le temps d’angoisse des prisonniers.
Il sera finalement condamné à trente ans de prison et transféré le 26 novembre 1940 au pénitencier de El Dueso (province de Santander). Cinq jours de trajet, souffrant de faim et de soif dans un wagon à bétail, pour quarante prisonniers, assis les uns contre les autres sans pouvoir bouger. Un matin il se réveillera avec, sur son épaule, la tête rigide de son voisin, un vieil anarchiste andalou, mort dans la nuit.
Otero Seco décrit le calvaire des prisonniers, faim, froid, entassement, crasse, humiliations constantes, angoisse, peur tantôt et tantôt acceptation de la mort, avec pour seuls moments d’évasion « le merveilleux monde sans frontières du sommeil » quand « le prisonnier ouvrait la porte du bonheur en plongeant dans l’inconscience ».
En quelques traits il dresse les portraits des camarades de défaite et sait redonner vie et dignité à chacun, comme il l’avait fait dans ses reportages sur le front pour les miliciens anonymes, qui mourraient « avec le mot liberté sur les lèvres ».
Regard de compassion et de sympathie, de tendresse sans doute, mais plus encore d’un profond respect et d’admiration pour le paysan, l’étudiant, l’instituteur, le soldat qui face à « la machine assassine du franquisme » se tient debout. Il raconte ainsi comment une nuit il est emmené à la direction de la prison. Croyant son heure venue il est pris d’une « peur incontrôlable qui lui noue la gorge » et croise « le regard d’adieu silencieux de ses compagnons » de cellule. Mais, en manque de fonctionnaires compétents, le directeur l’a fait appeler en réalité – parce que « journaliste et avocat il devait savoir écrire » -, pour qu’il rédige l’acte d’exécution au garrot d’un condamné à mort.
Dans la pièce réservée à cet effet « se dressait une petite estrade avec un poteau en bois auquel était accolé un siège à bras, décrit-il. Un peu au-dessus du dossier saillait un collier d’acier ouvert comme un U, uni à une manivelle qui permettait de l’ouvrir ou le fermer à volonté ». « Par une étroite lucarne du plafond, on pouvait distinguer les dernières étoiles et un croissant de lune blanc et brillant comme de l’étain », ne manque pas de noter le poète.
Le condamné qui ne devait pas avoir plus de vingt ans entre. « Quand nos regards se sont croisés il m’a salué d’un sourire presque imperceptible ». Il repousse le prêtre et refuse de se confesser et de communier. « Tu meurs comme tu as vécu, crie l’aumônier. Comme une bête. Tu vas brûler en enfer pour l’éternité. Tu as la mort que tu mérites. Dieu ne te pardonnera jamais ! »
« Le condamné se tenait bien droit, en parfaite verticalité, le dos collé au dossier du siège et les mains liées derrière le poteau, poursuit Otero Seco. Le large collier de fer, fermé, lui serrait le cou. Il a crié d’une voix ferme : « Vive la République ! ». Le bourreau a donné deux tours de manivelle. Mais ensuite, à la surprise générale, il l’a faite tourner rapidement en sens contraire.
La bouche tordue, d’où pendait une langue presque noire, a émis un léger gémissement guttural.
La tête de la victime s’est inclinée en avant sur le collier de fer et ses cheveux ont balayé son visage comme le Christ de Velasquez. »
Otero Seco verra sa peine réduite à cinq ans en régime de liberté surveillée. La première partie de la répression achevée, et les ennemis jugés les plus dangereux éliminés, de nombreuses condamnations furent considérablement réduites.
En quelques brèves scènes, Otero Seco raconte sa sortie de prison, saisi d’angoisse, « foulant une terre inconnue qui pourtant était ou devait être mon pays », avec l’impression de « porter gravée au front sa condition de prisonnier, d’homme en marge de la société, maudit et méprisé ».
Mais alors qu’il se met à marcher il rencontre cet adolescent, avec qui il échange à peine quelques mots et qui, le voyant fatigué avec sa valise à la main, l’invite à monter sur son âne, ce patron de café qui lui offre son premier et plantureux repas, ces employés des chemins de fer qui, devinant sa condition, n’hésitent pas à lui venir en aide, malgré les risques, comme dans un réflexe de solidarité naturelle.
Et dans « ces deux mondes, ces deux Espagnes » qu’il va devoir affronter, il verra une raison de ne pas renoncer à l’espoir et de conserver la foi dans l’humanité.
Un récit à lire à l’heure où les héritiers de la barbarie, les nostalgiques de la « croisade » franquiste, avec lesquels la droite « démocratique » n’hésite pas à s’allier, relèvent la tête en Espagne et où le parti néofasciste Vox accroit son audience. Ceux qui, malgré le vote de la loi de Mémoire historique « de réhabilitation des victimes de la Guerre civile et du franquisme », votée en décembre 2007, et les demandes réitérées de l’ONU ou du Conseil de l’Europe, se refusent à ce que l’Etat participe à la recherche et l’exhumation des plus de 100.000 hommes et femmes sommairement exécutés et enterrés par les franquistes jusqu’à 1945, voire au-delà.
Une tâche qu’ont entrepris les enfants et les petits-enfants qui continuent à se demander dans quel cimetière perdu, dans quelle fosse commune, dans quel champ de blé, sous quel olivier continuent à blanchir les os de leurs parents, comme l’a rappelé récemment le film El silencio de otros (Le silence des autres). Eux que les dirigeants de Vox n’hésitent pas à appeler les « buscahuesos », les « chercheurs d’os ».
Vie entre parenthèses, décrit les sinistres « paseos » (promenades) des victimes, comme les appelaient cyniquement les tueurs : « un long trajet nocturne en camionnette, un chemin désert jusqu’à la grille d’un cimetière, des hommes à peine éclairés par les phares du véhicule, des pelles et des pioches remuant la terre, maniées parfois par les propres victimes, quelques coups de feu, une fosse rapidement comblée… Aucune trace extérieure : ni jugement, normal ou sommaire, ni certificat de décès, ni nom sur le corps livré aux vers ». Car il ne suffisait pas de les tuer, il fallait les faire disparaître.
Le 2 mars dernier encore, le quotidien El Pais informait de la découverte d’une fosse commune à Madrid même, dans le cimetière de La Almudena, contenant les restes de 3.000 personnes exécutées par décision des tribunaux franquistes entre avril 1939 et février 1944.
Empêché d’exercer son métier de journaliste, Otero Seco vivra d’expédients divers dans une extrême précarité dans ce Madrid, devenu « une prison avec des tramways », comme il écrira dans un article dans Les Temps modernes. Très actif dans les réseaux de résistance, surveillé de près par la police, son domicile perquisitionné, il entrera en clandestinité en 1945 et sera finalement obligé de se réfugier en France en 1947. Sa femme et ses trois enfants, privés de passeport par le régime, ne pourront le rejoindre qu’en 1956.
A Paris il collabore avec le Gouvernement républicain en exil et plusieurs associations d’exilés. Il travaille comme traducteur pour l’ONU et l’UNESCO, écrit pour de nombreux journaux d’Europe ou d’Amérique Latine.
Nommé lecteur d’espagnol à l’Université de Haute Bretagne à Rennes, en 1952, puis maître-assistant, particulièrement apprécié par ses élèves, il sera également critique littéraire au Monde.
Il ne se fera jamais à sa vie d’exilé, «si dure, si pleine d’amertume quotidienne » avec au cœur « la nostalgie de ce qui aurait pu être et n’a pas été », comme il dira dans des lettres à ses amis. « Nous ne nous habituerons jamais à d’autres horizons », écrivait-il encore, rendant hommage à ses compagnons d’exil vivant
« avec une carte d’Espagne gravée dans la pupille ».
Il décèdera en 1970 sans avoir revu, comme il n’avait jamais cessé de l’espérer, « le sol – la terre – le soleil et le ciel d’Espagne ». « Là-bas en Espagne – quelle tristesse de dire « là-bas ! », disait-il à un ami.
« Mort de peine, mort d’angoisse, mort d’Espagne », écrira Jean Cassou.
Blog de Edouard Pons, journaliste, traducteur et militant de la mémoire.